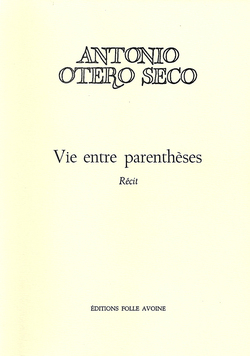-
Antonio Otero Seco, ou la mémoire d’une Espagne fracturée
Jacques Brélivet
Vie entre parenthèses : récit par Antonio Otero Seco,
traduit par Albert Bensoussan, éd. Folle Avoine, 2018Antonio Otero Seco fut un journaliste républicain espagnol, condamné à mort par le régime franquiste à la fin de la guerre civile de 1936-1939, peine commuée en condamnation à 30 ans de prison puis en liberté surveillée avec interdiction d’exercer son activité de journaliste et d’écrivain. Entré en clandestinité, il finira par s’échapper d’Espagne en 1947 pour se retrouver à Paris au sein de l’Association des Journalistes Espagnols exilés. En 1952, don Antonio, comme l’appelleront affectueusement ses collègues enseignants et ses étudiants, sera nommé lecteur d’espagnol à la Faculté des Lettres de Rennes. Il le restera jusqu’à son décès en 1970 sans avoir revu sa chère Espagne libérée tardivement du franquisme en 1975. C’est en 1952 également que la revue de Jean-Paul Sartre, Les Temps modernes, publiera son récit intitulé « Dans les prisons d’Espagne et dans la clandestinité ». Un récit qui fait écho à un autre texte, poignant, que viennent de publier les Éditions Folle Avoine, dans une belle et inédite traduction d’Albert Bensoussan, son proche et fidèle ami de l’université rennaise, sous le titre de « Vie entre parenthèses ».
La vie d’Antonio, natif de Badajoz, ville d’Estrémadure si violemment touchée par la guerre civile, est ainsi marquée de périodes successives et inégalement vécues : « parenthèse souriante » au début des années cinquante lors de cette échappée vers le nord glacé de l’Europe où il se rendit depuis son exil français pour assister au Congrès de la Paix, parenthèse heureuse et apaisée, aussi, quand il retrouvera femme et enfants à Rennes en 1956. Rares moments de sérénité, malgré tout, dans une vie à tout jamais marquée de cette mélancolie du déracinement qu’il portait dans ce regard triste et las d’un homme « exiliado » comme il est écrit sous le beau portrait peint par son fils Mariano que l’on peut voir sur l’un des murs de la Bibliothèque universitaire de Rennes 2. Parenthèse sombre et douloureuse, enfin, dans sa chair et dans sa mémoire, quand il est fait prisonnier à la fin de la guerre civile et qu’il est incarcéré à la prison de Porlier à Madrid puis à celle d’El Dueso.
« La guerre civile prit fin le 29 mars 1939. […] Et le 9 avril dans la nuit », trois hommes de la Phalange viennent cueillir Antonio à son domicile. L’un d’eux « était notre voisin à qui j’avais donné des leçons, quelques années plus tôt, pour son examen de droit romain, et il savait parfaitement qu’il ne trouverait personne ici capable de violence. Ni mon père, âgé de plus de soixante-dix ans et républicain modéré, ni ma mère, presque aussi âgé que lui, ni mes sœurs, catholiques et sans activité politique, ni moi, chez qui était encore inédite la sensation de tirer avec une arme à feu, aucun de nous ne pouvait mettre en péril la vie de ces trois hommes. » Aucun voisin ne bronchera, malgré tout, pas même ce curé que la famille pourtant connaissait bien, un homme jusque-là attentif et bienveillant, mais que les bruits de bottes et les cris de l’arrestation n’ébranleront pas une seconde. « Ce bon monsieur, sans doute plongé dans la lecture de son bréviaire, ne bougea pas d’un poil » écrit Antonio avec une amère ironie. Le père d’Antonio ne se remettra pas de cette férocité policière qui le touchait au plus profond de sa vie familiale et de ses convictions. « Deux mois plus tard, mon père est mort, mon nom et le mot liberté sur les lèvres, fanées par les années et les peines. »
Dit en quelques mots voilà ce que vivra tout au long de son récit Antonio pendant ces années de guerre et d’après-guerre : l’histoire d’un peuple et d’un pays brisés en deux où l’ami d’hier devient l’ennemi d’aujourd’hui. Un journaliste de ses anciennes relations, côtoyé et apprécié dans leur jeunesse commune, devenu juge du nouveau régime, poursuivra d’un zèle sadique et vengeur ses anciens collègues de la presse. « La frustration des médiocres a fourni à la répression franquiste ses agents les plus efficaces » relève Antonio avec une amertume doublée d’un découragement. La trahison s’avérera vite être la règle des opportunistes de tout poil : « La guerre civile fut le tremplin des audacieux, des pêcheurs en eau trouble, des petits malins, des hommes de proie, de ceux qui mettaient un rideau de fumée entre leur passé et leur présent. » De ce jour débuta le long temps de la confusion et du déchirement d’un pays tout entier qui allait durer plus de trois décennies.
De cette date d’avril a débuté pour Antonio le tunnel des épreuves carcérales et ses humiliations, cette nouvelle « vie entre parenthèses » vécue par un journaliste connu et reconnu (il fut le dernier à avoir interviewé le poète andalou Federico García Lorca quelques jours avant son exécution à Grenade). Avocat de formation et, « circonstance aggravante », vrai intellectuel, élève du philosophe Ortega y Gasset, Antonio fut, avec nombre de ses confrères, l’une des cibles privilégiées du nouveau régime. Et c’est la sentence de mort qui sera prononcée contre lui par un Conseil de guerre acharné à agir vite (« Moins de deux minutes par personne »), condamnant ce républicain intègre et honnête homme coupable de s’être « uni à la canaille, aux analphabètes, aux affamés, aux assassins, aux voleurs, à la lie de la société et aux ennemis de la civilisation, de la Patrie, de la propriété, de Dieu, de l’ordre et de la famille, traître à sa classe et aux siens ».
Les phalangistes dans leur brutalité primaire et leur idéologie mortifère (« Viva la muerte ! » vociféraient le franquiste José Millán Astray et ses troupes de la Légion étrangère) se fichaient bien qu’Antonio ait toujours été un apôtre de la tolérance, un homme pour qui aucune violence, de droite ou de gauche, ne pouvait se parer d’une quelconque légitimité. « J’étais journaliste professionnel. J’appartenais à un parti politique modéré et à un syndicat non moins modéré, reconnus officiellement par la loi » Voilà qui fait penser au témoignage et au récit de cet autre journaliste dont Antonio a peut-être été l’ami, Manuel Chaves Nogales, auteur d’un ouvrage magnifique d’humanité et de tendresse pour le peuple espagnol pris dans l’étau de la guerre civile, « À feu et à sang : héros, brutes et martyrs d'Espagne » (Gallimard, 2011, trad. de Catherine Vasseur, titre original : A sangre y fuego, 1937).
 Transféré par train de prison en prison, parmi les malheureux reclus, « quarante dans chaque wagon, quarante fantômes sales, haillonneux, dans une touffeur accablante », Antonio Otero Seco échouera au pénitencier d’El Dueso et sera le témoin, quand il n’en sera pas la victime, de l’intolérance d’hommes d’église sans pitié, de l’inhumanité de religieuses sans miséricorde, de l’opportunisme de directeurs de prison sans courage, du sadisme de geôliers sans conscience. En un mot, tout le théâtre de la noirceur humaine s’offrira à lui pendant les quelque trente mois de sa détention, seulement allégés par la présence lumineuse de don Pedro, un instituteur lui-même condamné à mort et dévoué à sortir les prisonniers de leur désespoir. L’homme de bonté, de foi et d’espérance ce fut lui, le laïc, nous dit don Antonio, et non pas ces veules religieux affidés au nouveau pouvoir.
Transféré par train de prison en prison, parmi les malheureux reclus, « quarante dans chaque wagon, quarante fantômes sales, haillonneux, dans une touffeur accablante », Antonio Otero Seco échouera au pénitencier d’El Dueso et sera le témoin, quand il n’en sera pas la victime, de l’intolérance d’hommes d’église sans pitié, de l’inhumanité de religieuses sans miséricorde, de l’opportunisme de directeurs de prison sans courage, du sadisme de geôliers sans conscience. En un mot, tout le théâtre de la noirceur humaine s’offrira à lui pendant les quelque trente mois de sa détention, seulement allégés par la présence lumineuse de don Pedro, un instituteur lui-même condamné à mort et dévoué à sortir les prisonniers de leur désespoir. L’homme de bonté, de foi et d’espérance ce fut lui, le laïc, nous dit don Antonio, et non pas ces veules religieux affidés au nouveau pouvoir.Antonio Otero Seco sortira finalement de prison après presque trois ans de détention, en liberté surveillée. Une liberté vécue étrangement : « J’étais saisi d’angoisse en foulant à nouveau une terre inconnue qui, pourtant, était ou devait être mon pays […]. Trente mois de prison pesaient sur moi comme une chape de plomb, la volonté et les sens mécanisés au son du clairon. » Prisonnier aussi, d’une autre manière et d’une forme de mauvaise conscience : il était libre quand d’autres de ses camarades de prison continuaient de souffrir et mourir dans les geôles de Franco. Et une liberté retrouvée dans une Espagne tragiquement et pour longtemps coupée en deux.
Don Antonio continuera sa vie et mourra en terre bretonne, en 1970, au milieu des siens, l’esprit toujours ailleurs, sans doute, dans cette Espagne qu’il n’aura jamais pu revoir. « Il est mort d’Espagne » écrira le poète Jean Cassou à la nouvelle de sa disparition. Dans le souvenir d’un pays et de ses amis à jamais perdus :
« Amis : Vous n’êtes pas morts. C’est nous maintenant
Qui mourons par vos vies, vivant de votre mort.
Éclairez notre vie qui sent la nostalgie
De votre mort vive chevauchant dans l’éternel. »(Aux Espagnols morts en exil, poème d’Antonio Otero Seco, in : Poésie II, 1950-1970, éd. Folle Avoine, 2016)
Jacques Brélivet
► Vie entre parenthèses : récit par Antonio Otero Seco, titre original : Vida entre paréntesis ; trad. d’Albert Bensoussan ; préf. de Jesús Izcaray ; ill. de José Robledano, éditions Folle Avoine, 2018, 115-VIII p., EAN 9782868102423. 20euros.
 Tags : Otero Seco, Brélivet
Tags : Otero Seco, Brélivet